Lutte contre la corruption et l’impunité : Où sont passés les dossiers de la COLDEFF ?
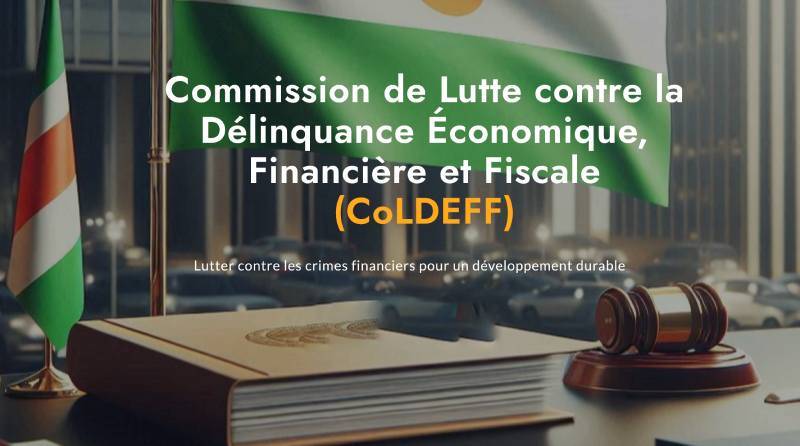
Depuis plusieurs jours, la capitale bruisse de rumeurs persistantes : les dossiers de la COLDEFF (Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale) auraient disparu. Selon des informations relayées dans les coulisses du pouvoir, des individus non identifiés se seraient introduits dans les locaux de l’institution pour en emporter la totalité des dossiers, vers une destination tout aussi inconnue. Cette opération menée dans le plus grand secret a plongé la COLDEFF dans un silence lourd, son personnel restant dans l’ignorance totale quant aux motifs et aux acteurs de ce retrait précipité.
À la COLDEFF, on assiste depuis à une forme de désœuvrement généralisé. Privée des dossiers qu’elle avait patiemment constitués, avec engagement et au service du peuple nigérien, la structure semble réduite à l’impuissance. Plus aucune enquête, plus aucun mouvement. L’institution s’apparente désormais à une coquille vide, que d’aucuns qualifient déjà d’« institution-fantôme ». La lutte contre la corruption et l’impunité, promise comme axe prioritaire de la refondation nationale, paraît à l’arrêt. Et pour une large part de la population, elle n’a même jamais réellement commencé.
Créée dans l’euphorie ayant suivi le coup d’État du 26 juillet 2023, la COLDEFF était perçue comme le bras opérationnel d’une volonté politique de rupture avec les pratiques mafieuses de la 7ᵉ République. Mais après des tensions internes, des querelles de leadership et un renouvellement de son bureau resté sans effet visible, l’institution semble avoir baissé pavillon. Depuis l’incident des dossiers disparus, aucun signal ne permet de penser que la COLDEFF agit encore. L’opinion publique n’a pas été informée d’une quelconque action en cours, ni d’un quelconque résultat. L’opacité est totale.
Ce silence alimente les doutes. Les Nigériens s’interrogent : pourquoi la transition collabore-t-elle avec certains des acteurs qu’elle avait elle-même pointés du doigt pour mauvaise gouvernance ou gestion défaillante de l’insécurité ? Cette contradiction renforce le sentiment d’incohérence. Car lorsque les militaires ont pris le pouvoir, les figures emblématiques de l’ancien régime se sont précipitées vers les frontières, parfois déguisées, pour fuir. La peur était palpable. Tout le monde croyait alors que justice serait faite. Une année s’est écoulée, puis deux, sans que les choses ne bougent. Et aujourd’hui, c’est le mot « pardon » qui s’impose dans le débat, reléguant les ambitions de rupture au rang de mirage.
Ce pardon, appliqué sélectivement à certains anciens responsables incarcérés, mais pas à d’autres, suscite la controverse. Il est vu comme un acte de réhabilitation déguisée, qui ouvre la voie à la réintégration politique d’individus que la transition elle-même avait déchus. Dès lors, les soupçons de complicité entre les autorités militaires et les anciens dignitaires s’en trouvent renforcés.
Au-delà de la question du pardon, c’est aussi le maintien de nombreux cadres de la 7ᵉ République dans l’administration qui alimente le malaise. Dans un État qui prétend se refonder sur les principes de justice, de compétence et d’intégrité, voir perdurer les pratiques d’affairisme, de favoritisme et de clanisme passe très mal. Où sont donc passées les Assises nationales ? Ces rencontres, censées tracer les lignes d’une refondation sincère, semblent avoir été utilisées comme un simple levier de communication, sans lendemain. Pire : aux yeux de nombreux Nigériens, elles n’auraient servi qu’à justifier la libération de prisonniers politiques devenus embarrassants à maintenir en détention.
Cette situation alimente une profonde amertume. Certains observateurs estiment qu’elle était prévisible, depuis que des personnalités proches de l’ancien régime ont commencé à refaire surface dans les cercles de décision. La transition, à force d’atermoiements, peine à convaincre qu’elle souhaite réellement instaurer une justice égale pour tous, dans un État républicain où nul ne devrait être au-dessus de la loi.
Pourquoi, se demandent les Nigériens, les militaires au pouvoir reculent-ils devant les dossiers brûlants de l’ancien régime, alors même qu’ils en avaient fait des priorités dans leurs premiers discours ? Est-ce une volonté de protection délibérée ? Un calcul stratégique ? Peut-on réellement bâtir une refondation nationale sur le déni de justice ? La réponse semble claire pour une majorité de citoyens : non.
Car la refondation, si elle veut s’inscrire dans la durée et dans la confiance, ne peut faire l’économie de la justice. Celle-ci n’est pas un supplément d’âme, mais une condition essentielle. Un État digne de ce nom ne protège pas les visages, il fait respecter la loi. Et tant que la lutte contre la corruption et l’impunité ne sera pas inscrite concrètement à l’agenda de la transition, celle-ci restera perçue comme incomplète, fragile, voire hypocrite.
Mairiga (Le Courrier)

